 Article initialement paru dans Laissons Faire, Numéro 5, Octobre 2013, pp. 18-22 et repris sur le site de l’Institut Coppet.
Article initialement paru dans Laissons Faire, Numéro 5, Octobre 2013, pp. 18-22 et repris sur le site de l’Institut Coppet.
On connaît tous l’abominable fiscalité de l’Ancien Régime, et l’image d’Épinal qui lui est associée : celle d’un paysan accablé sous le poids de l’impôt. En vérité, pourtant, le travailleur français moyen sous l’Ancien Régime payait l’équivalent de 18 jours de travail en impôts (gabelle, taille, vingtième, etc.). Aujourd’hui, il n’est quitte qu’après … 208 jours, soit dix fois plus. De quoi relativiser l’abomination de l’Ancien Régime, ou la supériorité de notre époque — ou les deux.
La question fiscale n’a, semble-t-il, jamais cessée d’être actuelle. C’est elle qui remue les débats contemporains ; c’est elle aussi, qui les remuait par le passé. Au début du XVIIIe siècle, c’est en adressant cette problématique éminemment importante que l’économie politique française fut fondée et se développa. Un auteur comme le maréchal Vauban consacrait son œuvre à la réforme de l’impôt, et conseillait la création d’une dîme royale (qui est le titre de son livre), c’est-à-dire d’un impôt proportionnel sur le revenu des personnes (flat tax), en remplacement de l’imposante fiscalité de l’époque. Le grand Boisguilbert, à la même époque, proposa une réforme similaire.
Écrivant un demi-siècle plus tard, les physiocrates, réunis autour de François Quesnay, eurent aussi en vue l’arbitraire fiscal de l’Ancien Régime. Ils publièrent leurs œuvres traitant du produit net et autres bizarreries, afin d’analyser les maux de la fiscalité du temps, et de dessiner les contours d’une réforme intelligente.
Ces écrits et ces hommes, si glorieux pour l’histoire de notre science, masquent cependant une réalité : que la fiscalité de l’Ancien Régime avait moins de défauts que la nôtre aujourd’hui. Ce sera le thème de notre article. Confrontant la fiscalité de l’Ancien Régime avec les mythes et les légendes dans lesquels les historiens, consciemment ou inconsciemment, l’ont trop longtemps enfermé, il tâchera de la mettre en balance avec celle de notre époque contemporaine, en prenant des critères d’évaluation les plus objectifs possibles.
Disons d’abord que la complexité du paysage fiscal français n’est pas nouvelle, et elle était en effet une caractéristique de l’économie de l’Ancien Régime. Les économistes libéraux ont bien pointé du doigt ce fait, et même les partisans de l’intervention de l’État dans l’économie se sont bercés de peu d’illusions sous ce rapport. Necker, qui offre le double avantage d’avoir été confronté directement aux finances de la France en tant que ministre, et d’avoir plusieurs fois réclamé l’intervention étatique dans la vie économique, ne ménageait pas la fiscalité française, et écrivait :
« Elle est tellement embrouillée qu’à peine un ou deux hommes par générations viennent à bout d’en posséder la science et qu’on ne peut rien réformer en partant des détails ; il n’y a, si possible, qu’à tout détruire. »
Même habitués à l’arbitraire fiscal et à un montant considérable de prélève-ments, nous ignorons souvent que pendant les siècles précédents, les impôts devaient systématiquement être légitimés, et expliqués, et qu’ils l’étaient en effet sous l’Ancien Régime. Chose étonnante pour nous, citoyens modernes, chaque nouvel impôt, durant l’Ancien Régime, était accompagné d’un édit royal qui en expliquait la finalité, souvent très précise (et souvent cette cause était une guerre).
L’impôt de l’Ancien Régime se fondait donc sur la constatation objective d’un besoin de l’État. La mentalité associée était donc tout à fait particulière, et les révoltes anti-impôts, qui suivront bientôt, s’expliquaient en grande partie par cette disposition. « Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, écrivait bien l’historien François Hincker, a persisté l’opinion que seule la guerre légitime vraiment l’impôt. »
Cette justification est fragile, on s’en doute. Elle sera rapidement balayée. Non pas que les guerres nouvelles aient vu les nouveaux impôts correspondants être attaqués ou refusés violemment par le peuple. Mais la progression du périmètre de l’Etat, et le creusement de ses déficits, aura pour conséquence de multiplier les occasions pour le Roi et les ministres de dire au peuple : Cet impôt, créé pour la guerre, restera valide en temps de paix. Et là naquirent les révoltes, qui fleurirent au XVIIe siècle, pour diminuer en nombre et en portée au cours du XVIIIe siècle.
Voilà un autre point que nous négligeons souvent : les révoltes anti-fiscalité furent des événements assez rares au cours du XVIIIe siècle. Aussi étonnant que cela puisse nous paraître, il est même établi que les impôts liés au système féodal, celui qui nous paraît le plus repoussant, furent dans l’ensemble mieux considérés, et nettement moins l’objet de révoltes, que les impôts royaux. Cela ne peut pas s’expliquer par notre distinction fictive entre impôts locaux et impôts nationaux. Cela provient de la réalité intrinsèque du système féodal. Dans ce système, les percepteurs des impôts jouaient un rôle social important : ou ils assuraient la sécurité de tous, ou ils constituaient un filet de sécurité en cas de mauvaises récoltes et de disette, ou encore, par leurs activités, ils faisaient naître autour d’eux un certain ordre, une certaine stabilité rassurante. Pour cet ordre, pour ce filet de sécurité, pour cette stabilité, le paysan français du Moyen Âge et de l’Ancien Régime semblait assez enclin à payer. Peu fréquentes sont en effet les révoltes qui concernent les tributs à verser aux seigneurs et propriétaires terriens.
La fiscalité d’Ancien Régime avait tout de même, certainement, de nombreux défauts. Nous verrons ce qu’il en est de la pression fiscale par la suite. Com-mençons par étudier les modalités d’organisation du vote et de la perception.
C’est un lieu commun que de dire que les impôts n’étaient pas levés, dans l’Ancien Régime, de façon démocratique : la main de l’Etat était implacable et la sévérité était insupportable. Cet énoncé est clairement excessif. D’abord, il y avait bel et bien des régions où l’impôt, ou du moins certains impôts, étaient votés, et non décidés d’en haut par les intendants et les ministres. La France de l’Ancien Régime se distinguait en effet entre « Pays d’état » et « Pays d’élection ». Comme le terme est très malhabile, précisons que les pays d’élection étaient les régions dans lesquelles l’impôt était décidé par en haut, par l’intendant (c’était le cas dans le Limousin de Turgot, ou dans l’Orléanais), et non par un parlement ou des instances régionales, comme c’était le cas dans les pays d’état (en Bretagne par exemple).
En outre, les quelques intrusions de la « souplesse » tant vantée, ainsi que de l’individualisation de l’imposition, étaient dans l’Ancien Régime des sources infinies d’abus. La taille, notamment, rassemblait toutes les dérives et tous les défauts fondamentaux de ce principe de souplesse. (1) Cet impôt, qu’on nous présente parfois comme le moins pire des impôts de l’Ancien Régime (sans doute parce que notre très actuel Impôt sur le Revenu en est l’héritier direct), laissait beaucoup de place pour la « souplesse », et semble admiré pour cela. Et pourtant, combien peu glorieuse est cette souplesse ! Déterminé subjectivement, le montant à verser par chaque « taillable » motivait les comportements d’esquive. Il fallait se montrer malin, feindre continuellement une incapacité à payer, sans quoi la rigueur du fisc était implacable. L’historien de l’économie Marcel Marion a bien décrit ce fait :
« Le collecteur de la taille était guidé par son sentiment de favoritisme, ou d’antipathie ou de crainte, ou de vengeance, ou plus souvent encore par la prévision de la difficulté plus ou moins grande qu’il trouverait à recouvrer chaque cote. Malheur au taillable dénué de protection, ayant ses biens à jour, ou ayant la déplorable réputation d’être un payeur exact ! C’est pour lui que la répartition de la taille réservait toutes ses rigueurs, alors qu’elle ménageait infiniment le plaideur endurci, le propriétaire influent, ou le contribuable forain. »
Notre TVA, qu’on dit moderne, avait aussi un équivalent à l’époque de l’Ancien Régime, bien que l’on ne s’en souvienne pas, et que peu de livres d’histoire en fassent mention. La gabelle du sel, qu’on présente comme une taxe particulière, levée sur une denrée bien spécifique, avait en réalité un application bien plus large, à peu près comparable à notre TVA. Parce que le sel était utilisé pour la conservation des aliments, en plus de la salaison, les énormes besoins provoquaient des rentrées fiscales considérables. Nous ne serons pas surpris d’apprendre, dans ces conditions, que cet impôt qu’on présente comme limité, rapportait un dixième de toutes les rentrées fiscales juste avant la Révolution. (2) L’impact de cette fiscalité sur le prix du sel n’est pas non plus à sous-estimer. Si nous considérons d’un côté la Bretagne, qui était exempte de la gabelle sur le sel, et de l’autre les régions qui la payaient, la différence de prix, de 5 deniers à 12 sous la livre, est dans un multiple de 1 à 30.
Lorsque nous considérons la fiscalité de l’Ancien Régime, nous sommes aussi obsédés, obnubilés par une disposition certes essentielle, mais qui provoqua très peu d’émeutes fiscales ou de réactions anti-impôt : je veux parler des privilèges, de ceux qui ne payaient pas d’impôts. Il n’est pas question de minimiser la portée des privilèges de la Noblesse ou du Clergé, mais il faut les mettre en perspective, afin d’expliquer pourquoi si peu de révoltes eurent comme motif précis ces inégalités flagrantes et majeures. L’une des réponses tient dans le fait que, compte tenu de l’organisation très lâche et multiforme de la fiscalité dans la France de l’Ancien Régime, le paysan breton, qui ne payait pas la gabelle sur le sel, paraissait tout autant si ce n’est davantage privilégié que le noble propriétaire de la terre, qu’on connaissait, qu’on fréquentait parfois, et qui nous avait peut-être aidé matériellement une fois ou deux.
D’ailleurs, les privilèges n’étaient pas aussi inexcusables qu’on veut bien le croire — du moins ceux de la Noblesse, car ceux du Clergé sont plus difficilement défendables, et furent davantage l’objet de plaintes de la part des paysans. Nous l’avons dit, l’impôt était souvent levé pour des raisons de guerre. Il servait à financer les expéditions militaires. Or, dans ces opérations militaires, si le paysan payait par sa bourse, le noble payait par sa présence au combat, et ce n’était pas un argument si facilement écartable, ni à l’époque, ni même aujourd’hui.
De ce dernier fait découle une caractéristique majeure du système fiscal de l’Ancien Régime, caractéristique que l’on retrouve malheureusement dans notre fiscalité contemporaine : la superposition de minuscules privilèges provoquait une paralysie complète du système, et l’empêchait de se réformer. Chacun ayant conscience d’être un peu privilégié par rapport aux autres sur un point particulier, il en oublie vite tous les autres domaines où il aurait beaucoup à gagner d’une réforme, et se met à refuser énergiquement toute évolution.
Au fond, dirons-nous pour conclure, la fiscalité de l’Ancien Régime n’était pas si atroce qu’on le croit, et, à tout prendre, si nous le croyons, des comparaisons avec notre époque devraient nous faire frémir. Écoutons les mots de François Hinckler, qui nous aide à faire cette comparaison dans son livre sur l’impôt sous l’Ancien Régime : « Utilisons un étalon artificiel mais qui a l’avantage d’être parlant. Les 25 millions d’habitants que compte probablement la France ont donc à payer 470 millions d’impôts, soit chacun entre 18 ou 19 livres. À ce moment le salaire journalier d’un compagnon maçon à Paris se situe à un peu moins d’une livre. Ainsi un salarié moyen travaillerait un peu plus de sept jours pour payer tailles, capitation et vingtièmes, un peu plus de deux pour payer la gabelle, et un peu plus de neuf pour payer les autres impôts indirects. » Dix-huit jours de travail : c’était la contribution que la fiscalité française de l’Ancien Régime réclamait au travailleur. Qu’en est-il aujourd’hui ? Avec un taux moyen d’imposition de 56,9% (chiffre 2013), il faut pas moins de 208 jours de travail pour payer en moyenne ses impôts de l’année. De quoi se demander si la Révolution française a servi à améliorer notre condition, et s’il ne serait pas temps d’en produire une nouvelle.
______________________________________________________________
(1) Son autre inconvénient, et non des moindres, est qu’elle était fixée ou répartie après constatation du montant des besoins de l’Etat : en d’autres termes, on commençait par décider combien on voulait prendre, puis on appliquait le taux d’impôt permettant d’obtenir la somme correspondante. S’il est bien un système qui, assurément, empêche l’Etat de se contenter de ses ressources, c’est bien celui-ci.
(2) Marcel Marion fournit, pour l’année 1715, les chiffres suivants : Recettes : 180 millions de livres, provenant pour 120 à 125 millions d’impôts irects, dont taille et capitation, et pour 55 à 60 millions d’impôts indirects comme la gabelle.




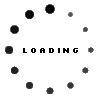
contrairement à ce que l’on croit la taile a perduré jusqu’après la guerre. en effet les personnes le désirant pour en guise d’impôt à la commune donner des jours de travail. Aujourd’hui des chômeurs ou des personnes à petit revenu aimairaient en bénéficier. d’autre part il y avait cette habitude d’assoir la grand mère sur le banc contenant le sel , et nul ne pouvait l’en faire lever. difficile alors de juger le montant de l’impôt.