
Les mots, on le sait bien, peuvent tuer. Ils sont des armes entre les mains de ceux qui les utilisent. Dans un monde dominé par l’image, l’évocation d’un seul mot suffira pour attirer la sympathie ou provoquer le dégoût. La politique, l’histoire et une certaine propagande (mais pourquoi séparer ces trois termes qui aujourd’hui, vont si bien ensemble !) ont chargé du poids de l’avanie certains termes que l’on peut aisément agiter comme des épouvantails ; ils en ont crédité d’autres de cet encens répandu sur tout objet sacré à l’heure des grands cultes.
Néanmoins, une étude un peu approfondie des termes, de leur signification et de leur histoire, nous amène parfois à des conclusions surprenantes, à la limite du cocasse : démystifiés et remis dans leur contexte d’origine, étudiés dans l’usage que les hommes en font, et celui de la réalité contemporaine, ils nous montrent une réalité peu engageante, tel un jeu de masques qui serait fort drôle, s’il n’était bâti sur le sang des hommes et sur leur honneur.
Arrêtons-nous sur un exemple concret : l’opposition entre absolutisme monarchique et démocratie républicaine. Je me permets de rapprocher ces termes, car ils sont pour l’un la forme du régime, et pour l’autre son exacte terreau idéologique, tout au moins dans le langage commun.
Ces deux réalités du vocabulaire politique sont fréquemment présentées pour être aux antipodes l’une de l’autre ; chargées idéologiquement et émotionnellement, elles cristallisent presque, pour nos contemporains, la caricature du Bien (république) et du Mal (monarchie). Il suffit d’ouvrir un dictionnaire des synonymes à chacun de ces termes pour constater l’abîme les séparant.
Et pourtant…
L’absolutisme est défini le plus souvent, dans son sens populaire, comme un pouvoir sans limite et sans contrôle, opposé au pouvoir limité du régime constitutionnel…
La réalité historique est tout autre : le terme absolutisme, apparu en 1796, est un néologisme péjoratif, inconnu au temps de la dite monarchie absolue ! Il est tout de même surprenant, au passage, de voir nommer une réalité par ce qui est tout son contraire ; les vainqueurs écrivent leur histoire qu’ils imposent à ceux qu’ils soumettent… Si donc ce néologisme n’existait pas dans l’Ancienne France, comment définissait-on, en ce temps, le pouvoir royal, et de quelle nature était cette souveraineté ?
De Bodin à Cardin Le Bret, en passant par Loyseau, les grands juristes de la seconde moitié du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe, non contents de la définir, cette souveraineté, la célébrèrent. Ce que Jean Bodin appelle république est « un droit gouvernement… avec puissance souveraine », (1576). Pour Loyseau, « la souveraineté n’est point, si quelque chose y fait défaut » (1608) ; selon Le Bret, « la souveraineté n’est non plus divisible que le point en géométrie » (1632). Le monarque étant parfaitement souverain, la monarchie française est absolue, c’est-à-dire parfaite. Absolue, c’est-à-dire sans liens, ce qui ne veut pas dire sans limites.
Le mot absolu, alors couramment utilisé, n’avait rien de péjoratif, bien au contraire. L’avocat général Omer Talon définissait la royauté comme « une puissance absolue et une autorité souveraine ». À la fin même du long règne de Louis XIV, lorsque la monarchie absolue, ayant connu son apogée, aurait pu être contestée après cinquante ans de règne, plusieurs coalitions, l’invasion étrangère, les manifestations de l’intolérance gouvernementale (interdiction du protestantisme, destruction de Port-Royal), on vit parfois critiquer le Roi, mais l’écrasante majorité des Français continua de complimenter, d’admirer et de vanter la monarchie absolue.
Si Fénelon conteste, un Pierre Bayle, protestant exilé, un père Pasquier Quesnel, janséniste exilé, défendent et illustrent la monarchie absolue avec presque autant de vigueur et non moins de conviction que Bossuet. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour entendre de véritables grincements. Partisan de ce qu’il appelle une « royauté monarchique », le marquis d’Argenson († en 1757), ancien ministre de Louis XV, critique la « monarchie absolue », selon lui porte ouverte au despotisme.
Sous sa plume, absolu a cessé d’être synonyme de souverain, ressemblerait à arbitraire au sens moderne et déplaisant du terme. Montesquieu, dans L’Esprit des Lois, dit sa préférence pour « un gouvernement modéré », substitué à la monarchie absolue, sans avoir l’air de voir que le régime de Louis XV, s’il est absolu dans l’ordre théorique, est parfaitement tempéré (ou modéré) sur le plan pratique. Le président de Montesquieu est, il est vrai, un idéologue. Voltaire, son contemporain, est, au contraire, attaché à la monarchie absolue. L’écrivain, qui applaudira le despotisme éclairé de Frédéric II en Prusse, et justifiera le coup d’autorité du chancelier Maupeou en France, ne craint pas d’écrire : « Un roi absolu, quand il n’est pas un monstre, ne peut vouloir que la grandeur et la prospérité de son État, parce qu’elle est la sienne propre, parce que tout père de famille veut le bien de sa maison. Il peut se tromper sur le choix des moyens, mais il n’est pas dans la nature qu’il veuille le mal de son royaume ».
On insiste beaucoup sur ce fait que le Roi réunissait entre ses mains les trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), mais nombreux étaient les contre-pouvoirs transformant la monarchie absolue en un régime tempéré.
Si le monarque avait à obéir au Décalogue (la loi de Dieu), il devait encore obéissance à d’autres lois : aux décrets, implicites, mais contraignants, du droit naturel (on appelait loi naturelle la morale universelle, commune aux païens et aux chrétiens, qui prescrivait notamment le respect des personnes et des biens) ; et, plus encore, aux lois fondamentales.
Les lois fondamentales, ou « lois du royaume », au cœur desquelles se trouvait la loi de succession de la Couronne, représentaient la constitution coutumière de la France. Elles étaient antérieures et supérieures au Roi, imprescriptibles et souveraines. Ces lois fondamentales, les vieux juristes aimaient à dire que « le Roi même se trouvait dans l’heureuse impuissance de les violer ».
Le roi était roi, et non un tyran, puisque le prince ne trouvait place qu’après le domaine de la foi, le droit naturel et l’ordre constitutionnel. Le souverain régnait et gouvernait ; il ne pouvait tout régler selon son caprice. Les actes royaux, ou « lois du Roi », émanés de sa volonté, ne devaient ni contrarier la loi de Dieu, ni contrevenir à la loi naturelle, ni violer les lois fondamentales sur lesquelles veillait jalousement le Parlement en sa qualité de « consistoire des lois ».
Ainsi, non seulement les lois du royaume transcendaient les pouvoirs du Roi, mais elles limitaient son autorité. Elles orientaient, par leur existence même, l’exercice par le prince de ses fonctions de législateur, puisque les lois du Roi n’étaient légitimes que dans la mesure où elles respectaient les règles et principes des lois du royaume. Monarchie absolue, la monarchie française se trouvait donc être aussi partiellement « constitutionnelle », dès lors qu’une constitution coutumière en fixait les limites.
Comment ne pas voir le contraste avec le pouvoir républicain tel qu’il existe depuis la Révolution ! Et combien le temps laisse à ce régime détestable le soin de se révéler tel qu’il est, dans la plénitude de son abjection ! On prétend que le pouvoir du roi était sans limites ; mais aurait-il pu statuer sur l’égalité entre homosexualité et hétérosexualité ? sur la théorie du « genre » ? sur l’ouverture du marché français à tous les produits étrangers sans contrepartie ? sur les délocalisations ? sur l’acceptation d’une religion monstrueuse, que l’on traite non plus à égalité, mais préférentiellement à celle qui a construit notre pays ? sur l’assassinat des enfants dans le ventre de leur mère ? bientôt sur celui des personnes âgées ? Jamais. Parce que ces domaines font partie de ce que l’on nommait très pudiquement, à cette époque, le « droit des gens », et qui étaient au-dessus de la loi royale, antérieur à ce que pouvait statuer le souverain, qui n’avait aucun pouvoir pour changer cet ordre des choses.
Mais pas la si vertueuse République.
Elle se montre aujourd’hui telle qu’elle a toujours été : un tyran sans visage, sans origine ni patrie, se prétendant universelle. Elle est par rapport au roi ce que Lucifer est à Dieu, cherchant à l’accuser de ses propres crimes, et le salir de ses turpitudes… Elle se pare du masque de la liberté et de l’égalité, servie par des suppôts qui décident en secret, en loges, les mutations qui permettront à la société française de voir naître cet homme nouveau, chimère de tous les totalitarismes.
Aucun roi de France n’a eu la puissance de la république ni cette volonté de destruction. Et on veut accuser d’absolutisme les souverains qui nous gouvernèrent ?
La séparation des pouvoirs pour éviter la tyrannie est tellement un leurre, que la République peut même se permettre de substituer le peuple pour lequel elle a été fondée, ce que de plus en plus de spécialistes nomment « le grand remplacement » : ce génocide qui ne dit pas son nom, et qui voit la lente disparition de ceux dont les origines sont incontestablement françaises, au profit de nouveaux arrivants, qui non seulement rejettent les valeurs du pays qui les accueille, mais qui, en plus, s’y installent en conquérants, appuyés par des traitres avides de conserver leurs prébendes et leurs privilèges.
Vous penserez, cher lecteur, que j’exagère, que mon discours manque de pondération… C’est que j’ai encore en mémoire ces centaines de milliers de Français dont le sang et la vie ont cimenté le pouvoir de la République en 1918 ; à ces millions de compatriotes qui souffrent dans leur chair et dans leur âme des lois iniques que la « souveraineté nationale », tyran monstrueux, leur impose depuis des décennies ; à tous ceux que la République n’hésitera pas à tuer si elle sent un jour, après avoir abusé de la patience des peuples de France, que le pouvoir lui échappe. Assurément, bien doux était le joug de nos rois, et bien léger leur fardeau ; puissent les peuples de France se réveiller de leur trop longue torpeur : il en va de leur survie.
Nicolas Ferrial
Le Lien Légitimiste, numéro 41 – Septembre-Octobre 2011




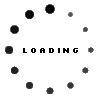
Excellent texte, dont la lecture est absolument nécessaire ! Ce genre de texte est à même de corriger tous les honteux mensonges assénés par le pouvoir républicain. J’ose espérer que de jeunes monarchistes auront à coeur d’entrer dans l’Éducation Nationale pour rétablir auprès de leurs élèves la vérité et ainsi leur donner envie d’être à leur tour royalistes. Il ne suffit pas de ne pas être un enseignant marxiste, il faut être royaliste ! C’est par l’école et avec l’aide précieuse de textes comme celui-ci que l’on pourra renverser la vapeur et faire de la monarchie le voeu politique de la jeunesse française.